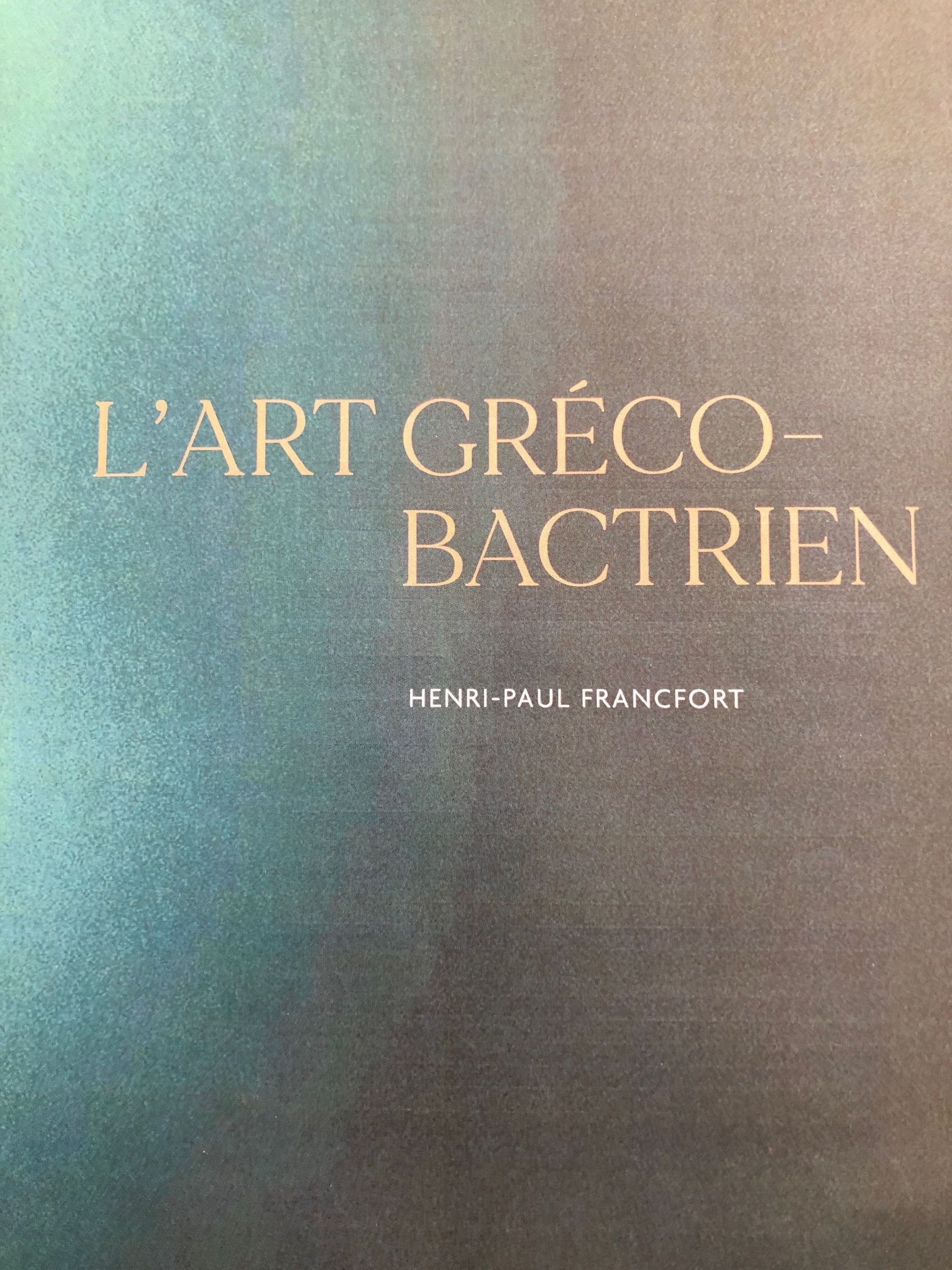
L' art Gréco-Bactrien, Henri-Paul Francfort
Δημοσίευση του αρχαιολόγου Henri-Paul Francfort για την ελληνοβακτριανή τέχνη.
Το άρθρο δεν είναι τόσο αναλυτικό (τι είναι αυτό που διακρίνει την ελληνοβατριανή τέχνη;) αλλά περισσότερο κάνει αναφορά στους τομείς/εκφάνσεις της τέχνης όπου η συνάντηση των δύο πολιτισμών δημιουργεί νέα εκφραστικά μέσα (αρχιτεκτονική, γλυπτική, μεταλλουργία, χρυσοχοϊα, κεραμική, πλαστική, κοσμηματοτεχνία κ.λπ.).
Αν και αναφέρεται σε "κοινή" ("koinè"), όρο που μεταχειρίζεται και η Rachel Mairs για να δηλώσει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό ρυθμό (και συνεπώς, μη καθαυτό ελληνικό), δεν είναι σαφές αν πρόκειται για διακριτό ρυθμό με διακριτή σχηματοποίηση και κανόνες, ή απλά για τα τυχαία υβρίδια (ανά παραγγελιοδόχο καλλιτέχνη ή/και χορηγό) που συνδιάζουν την τεχνική και τις παραδόσεις των Ελλήνων ή των ελληνικής/μικτής καταγωγής καλλιτεχνών, γιατί μάλλον τέτοιοι ήταν οι δημιουργοί και όχι εντόπιοι.
Το ερώτημα της ελληνοβακτριανής "κοινής", παραμένει ανοικτό προς διερεύνηση.
Το δεύτερο στοιχείο που συγκρατούμε είναι η διάρκεια της επιρροής της ελληνικής τέχνης στην Κεντρική Ασία και στην Ινδία. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί όπου η συνάντηση της ελληνικής με την εντόπια τέχνη είχε βαθύτερη και διαρκέστερη επίδραση είναι στα ελληνο-ινδικά παρά στα ελληνο-βακτριανά βασίλεια.
Αν και η διάρκεια των δύο υβριδικών βασιλείων είναι περίπου ίδια (κάτι λιγότερο από δύο αιώνες περίπου), εκεί όπου προϋπήρχε υψηλόβαθμος πολιτισμός και όπου διατηρήθηκε ένα υψηλό πολιτισμικό επίπεδο ακόμα και μετά την κατάλυση των Ελληνιστικών βασιλείων, εκεί ακριβώς ήταν διαρκέστερη, γονιμότερη και πλουσιότερη η καλλιτεχνική σύνθεση, δηλαδή η ελληνο-ινδική τέχνη της Γκαντάρα/Gandhara).
Παρατίθεται το αρχικό κείμενο στα Γαλλικά:
"L' art gréco-bactrien constitue une partie de l’art hellénistique, c’est-à-dire de l’art grec après Alexandre, entre 323 av. J.-C. et 31 apr. J.-C. Outre des propriétés intrinsèques, l’art hellénistique dans sa forme gréco-orientale se caractérise par une immense extension en Asie, sur les territoires des monarchies qui ont succédé à l’Empire perse achéménide, notamment celles des Parthes et des Séleucides (305-64 av. J.-C.)1. En Asie centrale, où de nombreux colons grecs s’étaient installés dès la fin du IVe siècle, le royaume gréco-bactrien se rend indépendant des Séleucides à partir de 250 av. J.-C., avec Diodote Ier (cat. 30), si bien que les artistes y ont exercé leurs talents dans le cadre des monarchies séleucide puis grécobactrienne. Cette dernière, dont les souverains règnent sur un royaume s’étendant entre le Syr-Darya et l’Hindou Kouch, a conquis l’Inde du Nord- Ouest après 200 av. J.-C., suivant les pas des Séleucides et d’Alexandre dont le souvenir, comme celui d’un nouvel Héraclès conquérant, était resté vif (cat. 40).
L’art gréco-bouddhique du Gandhara qui s’est progressivement développé sous les dynasties indo-grecques et indo-scythes est ainsi, avec l’art kouchan de l’Asie centrale, l’un des « descendants non-méditerranéens de l’art grec2 » bien connu en Asie. Cette expansion précéda de peu la fin du royaume grec de Bactriane vers 130 av. J.-C. Aussi l’art grécobactrien stricto sensu ne se développa-t-il qu’entre 250 et 130, durant une brève période, mais nous devons également prendre en compte les créations de l’époque séleucide précédente (entre 320-300 et 250) et de la période suivante, saka-yuezhi (entre 130 av. J.-C. et le Ier siècle apr. J.-C.), juste avant l’instauration de l’Empire kouchan (vers 100-375)3. Ses productions furent d’abord connues par des trouvailles isolées d’objets (des monnaies essentiellement : cat. 35), puis par les fouilles pratiquées en Bactriane, principalement dans le nord de l’Afghanistan à Bactres (Balkh)4 et à Aï Khanoum5, ainsi que dans le sud du Tadjikistan, à Takht-i Sangin6.
L’art gréco-bactrien est donc l’une des manifestations de l’art grécooriental que l’on identifie aussi en Syrie-Mésopotamie, en Iran, en Asie centrale et jusqu’aux contreforts du Pamir. Il s’épanouit dans le milieu urbain hellénisé de villes appelées parfois du nom de leur (re-)fondateur Alexandrie, Séleucie ou Antioche. Ces centres administratifs, militaires, commerciaux et culturels voient se coudoyer des Grecs venus de toutes les provinces et des Orientaux des mondes iraniens ou indiens. Les courants artistiques des capitales des royaumes et des provinces orientales, telles Antioche de Syrie, Alexandrie d’Égypte, Séleucie du Tigre, Milet, Pergame ou Ecbatane se répandent jusque sur les rives de l’Oxus, en Bactriane. Soldats, marchands, artistes, savants et philosophes parcourent de vieilles routes caravanières comme la « Grand’ Route du Khorassan », fréquentée depuis l’âge du bronze, qui relie le bassin de l’Oxus à la Mésopotamie. L’instauration de la monarchie parthe en Iran et en Mésopotamie ne semble pas totalement interrompre les échanges entre le monde méditerranéen, l’Asie centrale et l’Inde, préludes à la route de la Soie. Dans toutes ces régions, l’art grec rencontre des arts locaux, ceux de l’ancien Orient, et des arts nouveaux provenant du monde des steppes, des populations nomades, des Scythes en général. Cette koinè gréco-orientale inclut le Tadjikistan. Nous pouvons examiner ses réalisations artistiques, recueillies à Takht-i Sangin sur l’Oxus (Amou-Darya), et sur d’autres sites dans les vallées du Kyzylsou (Saksanokhur), du Kafirnigan (Kobadian), dans celles de Hissar et du haut Surkhan-Darya plus au nord (Douchanbé, Shahr-i Nau)7. La plupart de ces sites d’habitat ont livré des oeuvres d’art isolées et seul Takht-i Sangin, grâce à un grand programme de fouilles, peut se targuer d’offrir un ensemble complet malgré bien des vicissitudes, provenant d’un sanctuaire dédié à la grande divinité de l’Oxus (comme l’indiquent au moins trois inscriptions en grec) et de la ville dans laquelle il s’élève. Il peut nous servir de référence pour toutes les catégories d’oeuvres : architecture, sculpture, métallurgie, orfèvrerie et toreutique, glyptique et bijouterie, etc. Il nous permettra également de souligner les relations avec l’art contemporain d’Aï Khanoum (Afghanistan) et de Nisa (Turkménistan), complétant le corpus gréco-oriental, et avec les arts locaux non grecs, ainsi qu’avec ceux de leurs successeurs, après le départ des Grecs8.
Les Grecs introduisent en Bactriane leurs architectures et surtout des décors architecturaux, pour des monuments officiels, religieux ou publics. Ils sont connus principalement à Aï Khanoum (fig. 3), mais Takht-i Sangin en montre de beaux exemples. En effet, si peu de plans de bâtiments relèvent de la tradition grecque et si les murs sont plus souvent construits en brique crue que cuite, selon la tradition locale, certaines parties des édifices sont appareillées à la grecque. Des murs sont élevés en pierres soigneusement taillées et parées au ciseau à dents et des colonnes sont dressées comme dans le monde méditerranéen. Des bases profilées au tour, appelées atticoasiatiques ou samiennes, soutiennent de hauts fûts en pierre, dont les tambours sont assemblés à l’aide de goujons de bronze scellés au plomb que couronnent des chapiteaux ioniques (cat. 45), corinthiens ou doriques semblables à ceux de Milet, de Priène ou de Magnésie du Méandre en Asie Mineure. Les bâtiments monumentaux sont aménagés avec des socles moulurés en pierre supportant des statues de bronze dont presque rien ne subsiste sauf les traces de leur emplacement. Les toitures sont en partie couvertes de larges tuiles en terre cuite, leurs rives arborant des antéfixes moulées en palmette.
Rois et divinités sont honorés par la statuaire gréco-bactrienne⁹. Des sculptures en pierre sont importées ou taillées sur place dans le calcaire ou le marbre et la fonderie de bronze produit de grandes effigies dont ne subsistent que de rares fragments épars. Par leur technique et leur style, en relief ou en ronde bosse, ces effigies ne s’écartent pas des modèles méditerranéens. La petite sculpture nous est connue par des trouvailles d’Aï Khanoum et de Takht-i Sangin (cat. 60), comme le petit Marsyas aulète dédié à l’Oxus par un dénommé Atrosokès (cat. 44). Une spécialité de la sculpture gréco-bactrienne est le modelage, en terre crue ou en stuc, sur des armatures de bois et de cordelettes ; souvent polychromes, elles représentent des divinités ou des souverains (cat. 46 à 50). Les bronziers sont encore capables, vers la fin de l’époque gréco-bactrienne ou peu après, de se lancer dans la fonte de très grands cratères, inscrits en grec, au sanctuaire de Takht-i Sangin (cat. 63). L’anthroponymie révèle que les instigateurs de cette opération portent des noms qui ne sont pas grecs10.
Orfèvrerie et toreutique sont des domaines où brille la période hellénistique : coupes, plaques, plats en or et en argent se parent d’ornements et de scènes variées. Bien peu de ces productions nous sont parvenues de la Bactriane hellénisée, mais des plaques de bronze, ainsi que des moulages en plâtre et en argile destinés à reproduire les modèles, nous donnent une idée de la richesse du répertoire et de l’habileté des orfèvres et toreuticiens (cat. 27, 43).
Glyptique et bijouterie confirment le caractère éclectique de l’art gréco-bactrien : sceaux, bijoux et pendeloques diverses assemblent des matériaux locaux (tels que or, lapis-lazuli, grenat) et d’autres importés (tels que nacre, cornaline, corail, ivoire). L’on y remarque particulièrement bien les différences entre les habiletés et les traditions artistiques.De belles pièces en or, parfois rehaussées de pierres semi-précieuses, peuvent être admirées (cat. 55, 56). Dauphins, Éros, amphores, oves, postes, rinceaux et palmettes déploient un répertoire grec familier.
Les graveurs et ciseleurs sur pierre, os, coquille ou ivoire emploient des techniques de taille et d’incrustation de pierres fines. Une tradition bactrienne ancienne produit des pyxides, des couvercles gravés et des plaquettes en schiste marqueté (cat. 36). Des scènes narratives (chasse, bataille) (cat. 57, 61, 62) voisinent avec des êtres mythologiques (cat. 37, 39, 42, 65), dont une rare centauresse. Les ivoiriers cisèlent des pièces de haute qualité comme des rhytons semblables à ceux de la capitale parthe Nisa (Turkménistan) (cat. 38), un éléphant en ronde bosse (cat. 58) ou Alexandre en Héraclès (cat. 40). Des plaques à palmettes et rinceaux enjolivent des meubles ou même des armes. Rappelons que les expéditions en Inde des Séleucides, puis des Gréco-Bactriens (Démétrios Ier – cat. 32, Eucratide Ier – cat. 34, 35) ont ouvert l’accès aux riches ressources de ce continent.
Les trésors des sanctuaires et palais de Bactriane conservent encore des pièces d’époque ou de tradition achéménide (cat. 12, 13, 49), qui s’ajoutent aux oeuvres grecques ou grécisantes, à côté de productions indiennes11 et de celles, nouvelles, de l’art des steppes (cat. 15, 27). Les découvertes exceptionnelles de Takht-i Sangin doivent ainsi être rapprochées de celles d’Aï Khanoum, de Nisa et du trésor de l’Oxus (voir p. 52).
La tradition typique de l’art des steppes se manifeste dans le corpus de l’art gréco-bactrien, après la fin du pouvoir grec bien entendu, au cours de la transition vers l’instauration de l’Empire kouchan, à l’époque dite saka-yuezhi (IIe siècle av. J.-C. – Ier siècle apr. J.-C.). On la trouve à Takht-i Sangin même (cat. 15, 27), dans les tombes des nécropoles du Sud, de la vallée de Beshkent, de la région de Dangara et de Farkhor (cat. 71 à 75), et jusqu’à Saksanokhur avec la splendide plaque de ceinture en or de la chasse au sanglier d’un cavalier nomade dans un cadre décoré d’un rang d’oves (cat. 70)12.
L’art monétaire gréco-bactrien a suscité l’admiration de longue date13. L’unique monnaie en or de vingt statères d’Eucratide, surnommée l’Eukratideion, joyau de la BnF (voir p. 76), en est le plus fameux exemple. Les frappes monétaires nous font connaître de façon très vivante les portraits des souverains et le panthéon grec (Zeus, Athéna, Héraclès, les Dioscures, etc.) (cat. 30 à 35), qui fait une place à des divinités indiennes à partir du règne d’Agathocle. Ce monnayage continue avec des émissions comme celles des cavaliers yuezhi des premiers kouchans, tel Héraos (cat. 79). Elles portent des inscriptions écrites en grec, auxquelles les souverains qui régnèrent sur ou dans le nord-ouest de l’Inde ajoutèrent des légendes indiennes en écriture kharoshthi. Cela nous amène à observer que l’art gréco-bactrien comprenait, à côté des arts plastiques, une composante littéraire, une culture écrite. Par exemple, une inscription grecque censée provenir de Koulyab (?) est une dédicace en vers d’un certain Héliodotos à la déesse grecque du foyer, Hestia, pour la « préservation » avec l’aide de la Fortune (Tychè des Grecs), du roi Euthydème (Ier, vers 223-190 : cat. 33), « le plus grand de tous les rois » et de son fils Démétrios (Ier, vers 190-180), « glorieux vainqueur » ; ce dernier fut en effet le conquérant de l’Inde, coiffé pour cet exploit de la symbolique dépouille d’éléphant (cat. 32). Je donne ici la belle traduction de Georges Rougemont14 :
« L’autel parfumé que voici, c’est pour toi, déesse vénérable, illustre entre toutes, Hestia, que, dans le bois sacré de Zeus, plein de beaux arbres, il l’a construit et honoré de libations et de sacrifices éclatants, Héliodotos, afin que le plus grand de tous les rois, Euthydémos, ainsi que son fils – glorieux vainqueur –, le remarquable Démétrios, dans ta bonté tu les préserves de toute peine, avec l’aide de la divine Fortune. »
À côté des arts plastiques, musique, théâtre, littérature, science et philosophie étaient répandus dans les milieux grecs et hellénisés de la Bactriane : masques théâtraux et fragments de textes philosophiques, poétiques ou littéraires complètent la présence d’un théâtre à Aï Khanoum et les trouvailles d’instruments musicaux15. À Takht-i Sangin, la magnifique découverte d’une collection de flûtes doubles (auloi) en ivoire fait revivre les sons graves et puissants de ces hautbois.
Les intentions de l’art gréco-bactrien sont auliques, religieuses et populaires. Les formes les plus hellénisées dominent, à côté de courants orientaux, de l’ancien Orient et du nouvel Orient des steppes, dont la place devient de plus en plus importante au fil du temps, tandis que parallèlement se développent les échanges avec l’Occident gréco-romain et la Chine (voir Begram). Après la fin du pouvoir grec, l’héritage hellénique n’est pas totalement perdu. Ayant été largement transféré dans l’Inde du Nord-Ouest, il connaîtra un destin inédit à la suite des Indo-Grecs, sous les règnes des Indo-Scythes et des Kouchans, dans l’art gréco-bouddhique du Gandhara. En Bactriane cependant, une transmission de techniques et de formes, par exemple dans le décor architectural, s’opère par le truchement des nomades saka-yuezhi acculturés, comme au manoir de Saksanokhur et dans les villes avant et sous les Kouchans. Chez les nomades, l’art gréco-bactrien se retrouve ou survit dans du mobilier des tombes du Ier siècle de notre ère, au Tadjikistan on l’a vu, ainsi qu’à Tillya-tepa (Afghanistan) ou à Noin-Ula (Mongolie)16, où il côtoie des miroirs chinois importés. Chez leurs cousins installés et sédentarisés, il vit encore dans les décors de l’édifice dynastique de Khaltchayan et, soutenu par les cours royales, par les marchands et par le bouddhisme dans ses monastères, rayonne dans toute la Bactriane kouchane et postérieure (Aïrtam, Surkh Kotal, Balkh, Shahr-i Nau, Adjina-tepa, etc.). Certains éléments survivent encore dans l’art sogdien de Pendjikent (voir p. 158). Le plus remarquable, comme le montre l’épigraphie, est que l’onomastique et l’alphabet grecs restèrent en usage en Bactriane jusqu’au règne du Kouchan Kanishka (vers 127-152), contemporain de l’empereur romain Hadrien, et plus tard encore."